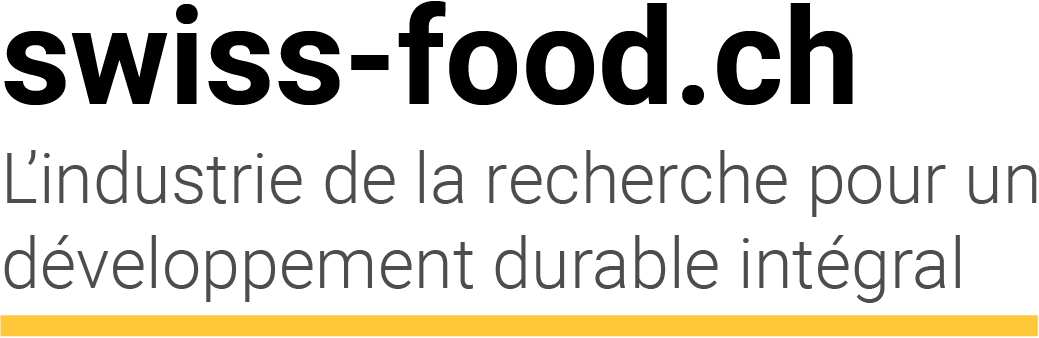Les autorisations deviennent un frein à l’innovation dans le monde entier – et l’agriculture reste sur le carreau
De nouvelles données en provenance des États-Unis illustrent ce qui est depuis longtemps une réalité en Europe et en Suisse : le développement et l’autorisation de nouveaux produits phytosanitaires sont devenus un processus si complexe, long et coûteux que même les solutions innovantes et durables peinent à atteindre le marché.
lundi 2 juin 2025
Même aux États-Unis, où la réglementation est traditionnellement fondée sur le risque, les fabricants atteignent de plus en plus leurs limites. Un rapport publié sur Agropages décrit de manière frappante comment même de grandes entreprises comme Syngenta ou Certis Biologicals se heurtent aux obstacles créés par les procédures d’autorisation actuelles.
Or c’est précisément maintenant qu’il faudrait rendre les nouvelles substances actives disponibles plus rapidement et plus efficacement. Le changement climatique modifie à une vitesse record la pression des ravageurs et les maladies, y compris en Suisse. Les résistances aux substances actives existantes augmentent. Dans le même temps, les exigences en matière de durabilité et de compatibilité environnementale s’accroissent — à juste titre. Mais pour répondre à ces exigences, il faut des avancées — et le progrès nécessite de l’innovation. Si ces innovations sont systématiquement freinées par les processus réglementaires, cela met en danger non seulement la productivité agricole, mais aussi la sécurité alimentaire ainsi que la protection de l’environnement et des sols.
Défis mondiaux croissants — et marge de manœuvre réduite
Au cœur du problème se trouvent les exigences croissantes au niveau mondial pour l’autorisation des substances actives. Ces dernières années, les demandes de données, d’études, de procédures de test et de documentation ont massivement augmenté. Aujourd’hui, l’approbation d’un nouveau produit phytosanitaire peut prendre dix ans ou plus — même lorsqu’il s’agit d’un produit biologique peu toxique qui devrait en principe être rapidement disponible.
À cela s’ajoutent des pénuries de personnel dans les autorités compétentes, une hausse brutale du nombre de demandes déposées et de nouvelles obligations — comme la protection des espèces et de la biodiversité — intégrées soudainement dans les procédures, entraînant des retards de plusieurs années.
Un exemple issu de l’article d’Agropages : une entreprise a soumis un produit à l’Agence américaine de protection de l’environnement (EPA) et a reçu l’assurance d’une approbation dans un délai de 90 jours. Peu avant la date limite, une évaluation supplémentaire des risques pour la protection des espèces menacées a soudainement été exigée — la procédure a finalement duré plus de deux ans. De telles situations entraînent non seulement des coûts supplémentaires massifs, mais aussi une incertitude de planification, pratiquement insupportable surtout pour les petites et moyennes entreprises.
Nouvelles technologies — accueillies sur le papier, bloquées dans la pratique
Ce sont précisément les nouvelles technologies dont on aurait un besoin urgent : des substances actives avec de nouveaux modes d’action capables de contourner les résistances existantes ; des formulations plus ciblées qui minimisent les effets secondaires sur l’environnement et les organismes utiles ; des applications numériques et des approches de développement basées sur l’IA qui pourraient améliorer l’efficacité et la durabilité. Mais tant que le cadre réglementaire reste aligné sur des structures obsolètes, ces innovations n’atteindront pas le marché. Les entreprises préfèrent alors investir dans la reformulation de substances existantes ou se retirer complètement de la recherche. Ce qui reste sur le carreau, c’est le progrès — et donc la capacité de l’agriculture à s’adapter aux conditions changeantes.
Il faut un nouvel équilibre entre sécurité et innovation
Bien entendu, des mécanismes de protection sont nécessaires — pour l’environnement, la santé et la biodiversité. Personne ne demande que la sécurité des procédures d’autorisation soit affaiblie. Mais une nouvelle approche réglementaire est nécessaire : les processus doivent devenir plus efficaces, plus transparents et plus prévisibles. Les outils numériques et l’intelligence artificielle ne doivent pas être considérés comme un objet de contrôle supplémentaire, mais comme des instruments d’accélération. Et surtout : l’accent doit à nouveau être mis sur le risque réel, et non uniquement sur des scénarios hypothétiques de pire cas. De plus, l’évaluation des bénéfices de la technologie à autoriser et des risques liés à sa non-utilisation doit devenir une partie intégrante du processus d’autorisation. Car refuser par crainte n’équivaut pas à maintenir le statu quo, mais à reculer. Le monde ne s’arrête pas.
Si nous voulons continuer à protéger efficacement et de manière respectueuse de l’environnement nos cultures à l’avenir, ces obstacles réglementaires doivent être ramenés à un niveau supportable. Ce n’est qu’ainsi que la recherche sur de nouvelles substances actives restera économiquement attractive et réalisable. Sinon, plus personne ne sera prêt à investir dans le développement — au détriment de l’agriculture, des consommateurs et, en fin de compte, de l’environnement.
Sources
Veuillez noter :
Notre équipe éditoriale n'est pas de langue maternelle française. Bien que nous accordons une grande importance à une communication claire et sans faille, parfois nous devons privilégier la rapidité à la perfection. Pour cette raison, ce texte a été traduit à la machine.
Nous nous excusons pour toute erreur de style ou d'orthographe.
Articles similaires

Les organisations environnementales provoquent le gel des autorisations
Les agriculteurs suisses peuvent de moins en moins protéger leurs cultures contre les parasites et les champignons. C’est le constat du journal suisse le Nebelspalter. Le nombre de substances phytosanitaires autorisées a chuté drastiquement depuis 2005.

Une approbation plus rapide des produits phytosanitaires est attendue depuis longtemps
La Suisse interdit activement des substances actives qui ont également été retirées du marché de l’UE. En revanche, elle freine lorsqu’il s’agit d’introduire de nouveaux produits : des moyens modernes, déjà autorisés dans les pays voisins, restent bloqués chez nous. Cela pourrait enfin changer. La Commission de l’économie et des redevances du Conseil national a adopté une proposition en ce sens.

700 pesticides en suspens d'homologation
La Suisse se trouve actuellement confrontée à un engorgement en matière d'homologation de pesticides. L'autorité compétente peine à traiter l'afflux des demandes, situation préoccupante pour les agriculteurs et l'environnement.

Le manque de diversité devient un problème existentiel
La diminution de la diversité génétique dans les champs est un problème croissant. Malheureusement, celui-ci ne cesse de s'aggraver, notamment parce que les responsables politiques en Suisse et dans l'UE abordent la question sous l'angle idéologique au lieu de se fier aux données scientifiques.

Recherche contre les maladies fongiques à Lyon
Les maladies fongiques comptent parmi les plus grandes menaces pour la production alimentaire mondiale. Elles mettent en péril les récoltes, causent chaque année des milliards de dommages et exercent depuis toujours une pression sur les agriculteurs. Un reportage détaillé de la RTS donne un aperçu du centre mondial de recherche et développement de Bayer à Lyon, où sont étudiés de nouveaux fongicides respectueux de l'environnement.

La science tire la sonnette d'alarme : le projet du Conseil fédéral freine l'innovation
Les nouvelles méthodes de sélection génomique sont considérées dans le monde entier comme porteuses d'espoir pour une agriculture résiliente au climat – précises, efficaces et sûres. Alors que des pays comme les États-Unis, le Japon ou bientôt l'UE misent sur la déréglementation, la proposition de réglementation du Conseil fédéral reste timide. Aujourd'hui, les chercheurs et l'industrie tirent la sonnette d'alarme : les règles proposées seraient si strictes qu'elles bloqueraient de facto l'innovation et l'application.

Pourquoi nous avons besoin de la haute technologie pour l'agriculture de demain
De l'édition génomique aux pulvérisateurs de précision, les innovations peuvent renforcer l'agriculture de demain. Elles contribuent à une meilleure utilisation des terres agricoles. Les cultures sont protégées plus efficacement. Selon un sondage de gfs.bern, les Suisses se montrent très ouverts à l'utilisation des technologies modernes. Cela vaut également pour les nouvelles méthodes de sélection telles que l'édition génomique.