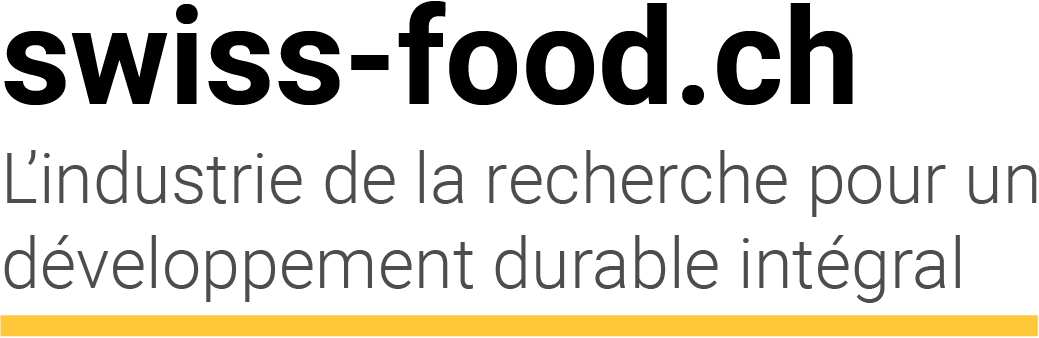Le manque de diversité devient un problème existentiel
La diminution de la diversité génétique dans les champs est un problème croissant. Malheureusement, celui-ci ne cesse de s'aggraver, notamment parce que les responsables politiques en Suisse et dans l'UE abordent la question sous l'angle idéologique au lieu de se fier aux données scientifiques.
lundi 15 septembre 2025
En réalité, on le sait depuis toujours : l'innovation ne déploie sa véritable valeur que lorsqu'elle passe des laboratoires de recherche à l'application pratique. Les universités et les laboratoires de l'industrie de la recherche sont des centres de connaissances, mais sans transfert vers la pratique, de nombreuses découvertes révolutionnaires restent inutilisées. Cela vaut tout particulièrement pour la recherche végétale : ce n'est que lorsque les résultats de la recherche seront mis en application dans les champs qu'ils pourront contribuer à garantir l'alimentation mondiale. Comme le montre une fois de plus un article paru dans la NZZ am Sonntag, les phytologues des universités suisses sont contraints de mener leurs recherches de pointe comme une sorte de combat contre de l'ombre. Car il est malheureusement permis de douter que leurs innovations aient un jour un impact.
Le temps presse : nos champs souffrent d'une pauvreté génétique. Et sans nouvelles méthodes de sélection, nous n'aurons pas non plus de diversité dans les semences. Mais au lieu d'utiliser des technologies modernes, telles que l'épigénétique ou la mutagenèse ciblée, pour renforcer la résilience de nos cultures, de nombreux décideurs restent bloqués dans leur position. Il est grand temps que ces milieux abandonnent leurs œillères idéologiques et écoutent la science. Car la situation actuelle est on ne peut plus contradictoire : ainsi, selon la Cour européenne de justice, la « mutation aléatoire » (random mutagenesis) est certes classée comme génie génétique, mais elle est largement répandue, même dans la culture biologique. En revanche, les méthodes beaucoup plus ciblées, telles que CRISPR, sont soumises à des lois strictes en matière de génie génétique et doivent rester interdites.
Des lois sans fondement factuel
Nicolaus von Wirén, directeur de l'Institut Leibniz de génétique végétale et de recherche sur les plantes cultivées, critique à juste titre dans l'article susmentionné : « Nos lois freinent le progrès sans fondement factuel. » La généticienne végétale Claudia Köhler, également citée, partage cette opinion : « CRISPR est une évolution de la sélection classique. Ceux qui l'interdisent ignorent les découvertes scientifiques et bloquent les solutions pour l'agriculture. » Il apparaît ainsi que de nombreuses méthodes de sélection, y compris celles autorisées en Europe, interviennent profondément dans le patrimoine génétique des plantes utiles. Cela inclut par exemple les sélections par mutagenèse, qui sont réalisées à l'aide d'irradiations chimiques ou radioactives.
Ce blocage politique concernant les méthodes de sélection innovantes est souvent justifié par les souhaits et les opinions de la population. Dans un sondage représentatif réalisé en 2024 par l'institut de recherche gfs, environ 77 % des personnes interrogées se sont déclarées opposées aux plantes génétiquement modifiées. Mais la même étude montre que lorsque les gens reconnaissent les avantages concrets des nouvelles méthodes de sélection, leur acceptation augmente considérablement. Elles obtiennent notamment de très bons résultats par rapport aux méthodes de sélection mutagène traditionnelles qui, comme mentionné précédemment, reposent en partie sur les rayonnements radioactifs ou les produits chimiques (ce qu'on appelle la mutagenèse). Cet aspect est souvent occulté dans le débat public.
Blocage également au niveau de l'épigénétique
Outre la technologie CRISPR, il existe un autre développement prometteur : l'épigénétique*. Elle étudie les mécanismes grâce auxquels les plantes adaptent leur patrimoine génétique de manière flexible aux changements environnementaux, sans modifier l'ADN lui-même. Les modifications épigénétiques sont réversibles, ce qui les distingue des interventions génétiques classiques. Malgré ce potentiel, les procédés épigénétiques, tels que ceux développés par la start-up suisse TEGenesis, sont bloqués pour des raisons réglementaires. L'entreprise attend depuis des années une autorisation, mais l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) considère sa méthode, qui consiste simplement à envoyer une impulsion chimique pour activer un processus d'apprentissage végétal, comme une technique génétique.
La réticence à l'innovation dans le domaine de la sélection végétale se manifeste également dans le débat sur les brevets. Les opposants critiquent souvent ces derniers en arguant qu'ils conduiraient à une monopolisation des semences. Mais c'est un malentendu. Les brevets ne protègent pas les semences elles-mêmes, mais les propriétés spécifiques développées grâce à la recherche. Comme l'a récemment souligné Michael Hengartner, président du Conseil des EPF, les brevets sont essentiels pour la Suisse en tant que pôle d'innovation. Ils garantissent la transparence, car les formules sont divulguées, et créent ainsi les conditions permettant à d'autres chercheurs de s'appuyer sur ces découvertes et de réaliser de nouveaux progrès. Il existe en outre des instruments efficaces, tels que les plateformes de licence, qui permettent également aux petits sélectionneurs d'utiliser des innovations brevetées.
La législation suisse dans le domaine de la sélection végétale a besoin d'une mise à jour scientifique urgente. Car l'agriculture de demain a besoin de solutions, pas d'interdictions.
Mutagenèse
Dans le cas de la mutagenèse ciblée, l'ADN est modifié à un endroit précis afin de provoquer une mutation. Des méthodes telles que CRISPR-Cas9 permettent de manipuler avec précision des gènes individuels. Ces technologies permettent d'activer, de désactiver ou de modifier des gènes spécifiques et ainsi de provoquer les changements souhaités chez les plantes. Ces approches sont interdites dans l'UE et en Suisse. Dans le cas de la mutagenèse non ciblée, des mutations aléatoires sont générées dans l'ensemble du génome d'un organisme. Cela peut se faire à l'aide de mutagènes chimiques, de rayonnements radioactifs ou d'autres méthodes. Les mutations surviennent dans différents gènes, sans qu'un objectif spécifique ne soit poursuivi. Cette approche est souvent utilisée pour générer un large éventail de mutants, parmi lesquels les caractéristiques souhaitées peuvent ensuite être sélectionnées. Une grande partie de nos plantes utiles, dont de nombreuses plantes biologiques, ont été modifiées de cette manière.
Épigénétique
L'épigénétique étudie comment les facteurs environnementaux influencent l'activité génétique sans modifier la séquence d'ADN. En agriculture, ces connaissances peuvent être utilisées pour rendre les plantes plus résistantes aux facteurs de stress tels que la sécheresse ou les maladies. Contrairement au génie génétique classique, qui intervient directement sur l'ADN, la modification épigénétique vise à activer ou désactiver des gènes à l'aide de marqueurs chimiques. Ces modifications sont souvent réversibles et peuvent parfois être transmises aux générations suivantes.
Veuillez noter :
Notre équipe éditoriale n'est pas de langue maternelle française. Bien que nous accordons une grande importance à une communication claire et sans faille, parfois nous devons privilégier la rapidité à la perfection. Pour cette raison, ce texte a été traduit à la machine.
Nous nous excusons pour toute erreur de style ou d'orthographe.
Articles similaires

Le génie génétique ? Oui, bien sûr.
En tant que consommateur, on l'ignore souvent : des produits annoncés comme sans OGM en contiennent depuis longtemps. Les opposants au génie génétique s'en offusquent. Mais il est plus facile de passer le « scandale » sous silence – car quelque chose que nous mangeons depuis longtemps ne nous fait plus peur.

Recherche contre les maladies fongiques à Lyon
Les maladies fongiques comptent parmi les plus grandes menaces pour la production alimentaire mondiale. Elles mettent en péril les récoltes, causent chaque année des milliards de dommages et exercent depuis toujours une pression sur les agriculteurs. Un reportage détaillé de la RTS donne un aperçu du centre mondial de recherche et développement de Bayer à Lyon, où sont étudiés de nouveaux fongicides respectueux de l'environnement.

La science tire la sonnette d'alarme : le projet du Conseil fédéral freine l'innovation
Les nouvelles méthodes de sélection génomique sont considérées dans le monde entier comme porteuses d'espoir pour une agriculture résiliente au climat – précises, efficaces et sûres. Alors que des pays comme les États-Unis, le Japon ou bientôt l'UE misent sur la déréglementation, la proposition de réglementation du Conseil fédéral reste timide. Aujourd'hui, les chercheurs et l'industrie tirent la sonnette d'alarme : les règles proposées seraient si strictes qu'elles bloqueraient de facto l'innovation et l'application.

Les autorisations deviennent un frein à l’innovation dans le monde entier – et l’agriculture reste sur le carreau
De nouvelles données en provenance des États-Unis illustrent ce qui est depuis longtemps une réalité en Europe et en Suisse : le développement et l’autorisation de nouveaux produits phytosanitaires sont devenus un processus si complexe, long et coûteux que même les solutions innovantes et durables peinent à atteindre le marché.

Pourquoi nous avons besoin de la haute technologie pour l'agriculture de demain
De l'édition génomique aux pulvérisateurs de précision, les innovations peuvent renforcer l'agriculture de demain. Elles contribuent à une meilleure utilisation des terres agricoles. Les cultures sont protégées plus efficacement. Selon un sondage de gfs.bern, les Suisses se montrent très ouverts à l'utilisation des technologies modernes. Cela vaut également pour les nouvelles méthodes de sélection telles que l'édition génomique.